Philippe de Lenoncourt, neveu du cardinal Robert, son prédécesseur, était fils de Henri, seigneur de Baudricourt et de Vignory, comte de Nanteuil-le-Haudoin, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur du Valois, bailli de Vitry, etc., chambellan du roi, et de Marguerite de Broyes, dame de Nanteuil, Pacy et autres lieux. Il naquit en 1527, au château de Coupvray, entre Meaux et Lagny. Dans sa. jeunesse, il alla à Rome avec son oncle en 1540; il n'avait alors que treize ans, et les Italiens le surnommaient le beau cavalier français. Peu après, il entra dans le clergé, et fut pourvu des abbayes d'Épernay, de Montier-Saint-Jean, d'Oigny et de Saint-Martial de Limoges, ainsi que de l'évêché de Châlons-sur-Marne en octobre 1550, dont il se démit en 1556, en devenant abbé de Montier-en-Der et grand-vicaire de son oncle qui lui résigna l'évêché d'Auxerre le 7 février 1560.
Philippe de Lenoncourt prit, possession de ce siége avec grande pompe, le 8 décembre 1560. Le roi, en sa qualité de comte d'Auxerre, délégua pour le porter, Claude d'Heu, son procureur, et Girard Rémond, doyen des conseillers au bailliage d'Auxerre. René de Pernay et Jean de Chelles représentèrent le duc de Nevers, pour la seigneurie de Donzy, enfin René de Prie représentait Edmond ou Aimar de Prie, son père, baron de Toucy. La cérémonie fut suivie d'un magnifique repas auquel assistèrent tous les membres du clergé de la cathédrale. Le lendemain de cette prise de possession, le chapitre députa plusieurs dignitaires au prélat, pour le prier de renfermer dans une nouvelle châsse d'argent les reliques de saint Chrysanthe. Si Philippe y acquiesça, ce qu'on ignore, ce fut peut-être le seul acte important et mémorable concernant l'église cathédrale, qu'il ait fait pendant les deux années et demie que dura son épiscopat. Un procès contre le duc de Guise l'occupa considérablement. Le roi de Navarre, qu'il aida de ses conseils, lui fit perdre aussi beaucoup de temps. Dans ces embarras, il eut pour vicaire général Gaspard Damy que son oncle, le cardinal de Lenoncourt, avait amené de Châlons, et le diocèse ne fut pas moins bien soigné que si l'évêque l'eût dirigé personnellement. D'ailleurs, au commencement des troubles occasionnés par les Calvinistes, le chapitre de la cathédrale partagea une partie de la sollicitude pastorale.
Le duc de Guise avait acheté de Marguerite de Broyes, mère de Philippe de Lenoncourt, la terre de Nanteuil-le-Haudoin au diocèse de Meaux. Philippe voulut rentrer dans la possession de ce bien. Son crédit auprès du roi de Navarre, peu ami du duc de Guise, lui fut très utile en cette circonstance, et empêcha la tenue d'un concile national qui avait été demandé par le chancelier de France après le colloque de Poissy. Le pape qui appréhendait ce concile, fit faire des démarches par le roi d'Espagne auprès d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, lieutenant-général du royaume sous Charles IX. "Le cardinal de Ferrare et les Guise, dit l'abbé Lebeuf, songèrent à amuser le roi de Navarre, et, par la voie du maréchal de Saint-André, ils firent entendre aux deux plus grands confidents de ce prince, qui étaient l'évêque d'Auxerre et François d'Escars, que s'il répudiait Jeanne d'Albret, sa femme huguenote, il pourrait devenir roi d'Angleterre et d'Écosse. Un historien judicieux rend, à cette occasion, un témoignage qui marque la droiture de notre prélat, et qui le disculpe suffisamment, Philippe de Lenoncourt, dit-il, ayant l'âme aussi noble que la naissance, mais l'esprit un peu facile et d'ailleurs enivré de cette vanité courtisane, pouvait être plus aisément trompé que corrompu" (Mézeray.)
Lorsque Charles IX eut quitté Fontainebleau pour venir demeurer à Paris et se conformer ainsi au désir des catholiques, l'évêque d'Auxerre fut admis au conseil en considération de la faveur qu'il avait auprès du roi de Navarre, et porta ce prince à préférer l'alliance du duc de Guise et du connétable Anne de Montmorency à celle du prince de Condé, son frère. De là l'origine des calomnies dont les huguenots essayèrent de noircir la réputation de Philippe de Lenoncourt, qui prit séance au parlement de Paris, avec voix délibérative, le lundi 27 avril 1562.
Prévoyant la longueur de son absence et ne voulant pas que, à cette époque si périlleuse pour la foi, son diocèse fût privé des avantages de la visite d'un évêque, il prit pour vicaire général François Menjart, évêque de Négrepont, le 27 mai 1562, en même temps qu'il établissait, le même jour, Gaspard Damy son vicaire général pour tout ce qui regardait le prieuré de La Charité-sur-Loire qu'il avait obtenu de son oncle en échange de celui de Nanteuil.
Philippe se voyant obligé de rester à la cour, finit par se démettre de son évêché d'Auxerre, en septembre 1562, comme on peut en juger par la date des bulles de son successeur, qui sont du 16 décembre de cette année. Le cardinal de la Bourdaisière, en faveur de qui il abdiqua, lui donna en retour l'abbaye de Rebais, ne retenant sur ce bénéfice qu'une pension de mille livres. Philippe de Lenoncourt vécût encore trente ans après son abdication. Henri III le fit chancelier de l'ordre du Saint-Esprit à la première promotion du 31 décembre 1578, et l'envoya en 1585 auprès du roi de Navarre pour l'engager à abandonner le parti de l'hérésie. Le pape Sixte V, qui avait en lui la plus grande confiance, le revêtit, en 17 décembre 1586, de la pourpre romaine, et le fit président de la congrégation de l'Index: Pendant la tenue des États de Blois en 1588, le cardinal de Lenoncourt, qui avait été titré cardinal de Saint-Onuphre, fut atteint d'une maladie de foie qui l'affaiblit tellement, qu'on fut obligé de lui donner une nourrice et de l'allaiter comme un tout jeune enfant. A cette énorme après l'assassinat du cardinal de Guise, Sixte V le nomma à l'archevêché de Reims; mais cette nomination demeura sans effet, et Philippe, retourné à Rome pour quelques affaires, y mourut le 13 décembre 1591, à l'âge de soixante-cinq ans.
Lorsque le cardinal de Lenoncourt se disposait au voyage de Rome pour y recevoir le chapeau, il emprunta du sieur de Rentigny, gouverneur de Meaux, une somme assez considérable, qu'il ne se pressa pas beaucoup de rendre. Pour se faire payer, Rentignv marcha le 10 octobre 1590, sur la ville et le monastère de Rebais dont le cardinal avait été abbé, et les mit au pillage. Après la mort de Philippe, son cœur fut apporte dans l'abbaye, mais des chiens le dévorèrent, et ce fait parut au peuple une juste punition de l'ambition du cardinal, qui avait fait enlever l'or, l'argent et les pierreries dont toutes les châsses de l'église abbatiale étaient ornées, pour augmenter son train et pour faire dans Rome une entrée plus pompeuse et plus magnifique. On dit à cette occasion que le charretier, chargé de conduire les châsses à Paris, criait en revenant, qu'il était damné, et l'on ajoute qu'en passant sur la chaussée de l'étang de Francheville, il s'y précipita de désespoir. Lorsque le château de Rebais fut pris par Rentigny, le cardinal avait résigné l'abbaye à Philippe de Lenoncourt, son neveu, que l'on a surnommé l'ivrogne, à cause de ses excès et de ses débauches de table.
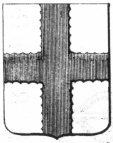 |
Philippe de Lenoncourt portait les mêmes armoiries que son oncle, d'argent, à la croix engrelée de gueules. |