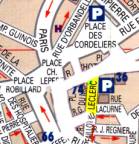 Cette place
s'appelait avant la dernière guerre : place Fourier ou une statue de ce
savant été érigée. Elle était l'œuvre du sculpteur Faillot et fut enlevée
pour être fondue par les allemands La place a existé de tout temps et jusqu’au milieu du XIXe siècle,
il s'y trouvait le palais de justice, qui fut d’abord le palais des comtes, et
même, si l’on en croyait certaines opinions, la demeure des rois de la première
race, dont plusieurs, tout au moins, y ont fait de fréquents séjours.
Cette place
s'appelait avant la dernière guerre : place Fourier ou une statue de ce
savant été érigée. Elle était l'œuvre du sculpteur Faillot et fut enlevée
pour être fondue par les allemands La place a existé de tout temps et jusqu’au milieu du XIXe siècle,
il s'y trouvait le palais de justice, qui fut d’abord le palais des comtes, et
même, si l’on en croyait certaines opinions, la demeure des rois de la première
race, dont plusieurs, tout au moins, y ont fait de fréquents séjours.
Dès les premiers siècles du régime des Mérovingiens, ces souverains,
ou les comtes, leurs représentants, s’étaient installés à l’extrémité
sud-ouest de la cité, tandis que les évêques en occupaient la partie Est. De
cette manière, chacun était chez soi et n’empiétait pas sur le terrain
d’autrui.
Un écrivain très autorisé a raconte tout récemment l’histoire de
ce vieux palais (Conférences faites à Auxerre en 1868, Le Château des
Comtes, par M. A Challe).
En déblayant le sol des bâtiments de l’ancienne prison, pour dégager le
palais proprement dit, qui venait d’être cédé à la ville par le département,
en 1861, on a reconnu l’enceinte d’une vaste tour de plus de 22 mètres de
diamètre. M. Challe veut voir là la tour de Brunehaut, cet édifice dont
parlent les vieux chroniqueurs et qu’avait signalé M. Leblanc dans ses intéressantes
Recherches sur Auxerre. Quoiqu’il en soit, ce vaste donjon du château
des comtes n’aurait-il été bâti qu’au XIe siècle, à l’époque des
grandes constructions féodales, il serait encore un monument curieux; il en
reste un pan circulaire du côté de la rue des
Boucheries. On a également trouvé, dans les derniers travaux de déblaiement,
d’autres murs d’une ampleur énorme et d’une dureté comparable à celle
des murs romains. Une partie de ceux-ci s’est aussi rencontrée dans le
prolongement du pignon actuel du palais, et allant rejoindre la grande muraille
qui part de la Tour-Gaillarde et qui est
assise sur les fondements de ce même mur romain. On remarque encore à sa base
un pan formé de moëllons réguliers et de petit appareil, qui en accuse
l’origine.
En démolissant un autre pan de ce mur, du côté de la rue Lacurne, en 1840, on a trouvé, au soubassement et la face en
dedans, un beau morceau de sculpture, représentant un cheval marin buvant dans
une coupe (Musée de la Ville).
Les Gestes des évêques d’Auxerre nous parlent d’une chapelle de Saint-Alban, élevée dès le Ve siècle par saint Germain dans le château des comtes. On n’en a pas retrouvé de traces dans les derniers travaux. Au XIIe siècle, le château s’ouvrait sur la rue de l’Horloge actuelle, par une arcade que nous voyons encore, et, au siècle précédent, il y avait sur la place intérieure, un orme sous lequel le comte Guillaume I et ses successeurs édictaient leurs actes publics (Data in castello, sub ulmo, porte une charte).
Un incendie détruisit la chapelle Saint-Alban, ainsi que le reste de la
cité, vers l’an 890, mais cette église échappa au désastre de l’an 1023.
Les bourgeois d’Auxerre reçurent, au XIIIe siècle, de la comtesse
Mathilde, la permission de s’assembler dans une des salles du palais, pour
leurs réunions publiques.
Plus tard, en 1367, à la réunion du comté à la couronne, le roi y établit
le siége d’un bailliage royal, qui subsista jusqu’en 1789. On appelait
alors le palais la Maison royale. Sous Louis XII, en 1509, l’édifice, depuis
longtemps en ruines, fut l’objet de réparations. En 1602, un arrêt du
conseil d’Etat prescrivit sa reconstruction, attendu son état de vétusté.
Mais ce ne fut guère qu’en 1647 qu’on put poser la première pierre du
nouvel édifice, après l’approbation d’un marché fait avec Claude Martin,
maître-architecte du roi à Fontainebleau, qualifié, « entrepreneur des château
et maison royale, prisons et conciergerie d’Auxerre » (Archives de I’Yonne,
A 6 ; marché du 11 janvier 1617 et compte.), et qui avait dressé le plan du nouvel édifice, et le devis s’en élevait
à 78 mille livres. Mais on ne s’arrêta pas là, et M.
Chardon raconte qu’il fut achevé en 1622, et coûta plus de cent mille
livres aux paroisses du bailliage, sur lesquelles cette somme importante avait
été imposée.
Le caractère du palais actuel est bien, en effet, dans le style du
temps de Louis XIII aspect solide, murs en briques, pilastres à chapiteaux
doriques ; sur la frise des guirlandes, non terminées; la partie postérieure
de l’édifice a été modernisée tout-à-fait. Les troubles de la Fronde ne
permirent pas d’entretenir longtemps le palais en bon état, car, en 1667, il
fallut que les officiers du bailliage allassent tenir leurs audiences à l’hôtel-de-ville,
et cela dura plusieurs années, par la négligence du receveur du roi à faire
faire les réparations. Un rapport de prudhommes constatait qu’il y avait pour
aller aux salles une montée de bois tout en ruines, en sorte qu’il était périlleux
d’y monter. Ce n’est que huit ans après qu’on y porta remède.
On peut voir, dans la conférence faite par M.
Challe, comment, en 1867, la ville, propriétaire du vieux palais, voulant y
installer sa bibliothèque et son musée, y a fait, sous sa direction de
nombreux travaux d’appropriation; comment on a fait disparaître plusieurs édifices
parasites qui obstruaient la vue du palais, et comment on à bâti sur la façade
un grand pignon en brique et pierre, dans le style Louis XIII, comme le corps du
bâtiment.
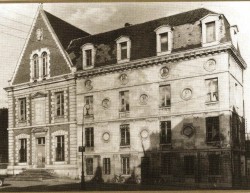 Au côté droit de ce pignon s’étend un bâtiment moderne à trois étages,
construit en 1823, pour servir de prison et améliorer cette partie du service
qui laissait beaucoup à désirer. Il est sans aucun caractère, mais on l’a
approprié à l’intérieur à sa destination scientifique. M. Challe a eu
l’heureuse idée d’y faire incruster des médaillons reproduisant les traits
ou rappelant au moins le souvenir des hommes « qui dans ce pays avaient acquis
le plus de renommée dans les lettres, les sciences et les arts » (M. ChaIle,
Conférences ibid.)
Au côté droit de ce pignon s’étend un bâtiment moderne à trois étages,
construit en 1823, pour servir de prison et améliorer cette partie du service
qui laissait beaucoup à désirer. Il est sans aucun caractère, mais on l’a
approprié à l’intérieur à sa destination scientifique. M. Challe a eu
l’heureuse idée d’y faire incruster des médaillons reproduisant les traits
ou rappelant au moins le souvenir des hommes « qui dans ce pays avaient acquis
le plus de renommée dans les lettres, les sciences et les arts » (M. ChaIle,
Conférences ibid.)
Ces médaillons sont dus au ciseau d’un amateur Auxerrois, M. Michelon,
et ne sont pas indignes d’attention. Ils rapellent les traits : 1° d’Héric,
moine de Saint-Germain et poète au IXe siècle; 2° de Jean Régnier, poète et
bailli d’Auxerre au XVe siècle ; 3° de Jacques
Amyot, savant écrivain et évêque du XVIe siècle ; 4° de La Curne de
Sainte-Pallaye, académicien ; 5° de l’abbé
Lebeuf; 6° de Soufflot, l’architecte du Panthéon, tous du XVIIIe siècle;
7) enfin du docteur
Roux, chirurgien célèbre. Il reste encore des places vides sur cette façade,
pour recevoir les bustes de nos futurs grands hommes.
Terminons cette énumération en signalant encore l’effigie de la
comtesse Mathilde du XIIIe siècle, qui s’élève sur la façade sud du même
bâtiment, et enfin le portrait de Pierre de Courtenay, le rude comte d’Auxerre,
devenu, pour son malheur, empereur de Constantinople, et qui le premier, en
1188, accorda aux habitants d’Auxerre une charte de franchises.
C’est dans cette attitude de libérateur qu’il est représenté sur
la face nord du grand pignon du palais. M. Michelon lui a donné l’air énergique
que ses actions lui font supposer. Une élégante et ferme composition de style
renaissance lui sert de cadre.
L’intérieur de l’ancien palais n’a rien conservé de sa physionomie
primitive, Si ce n’est au rez-de-chaussée des salles voûtées qui servaient
de prisons, et au premier étage la salle dite du conseil, ancien cabinet
de lecture de la Bibliothèque publique Un plafond à solives apparentes, une
large cheminée ayant sur ses pieds-droits deux statues médiocres de la Justice
et de la Force, voilà les seules choses anciennes du palais qu’on y voit. Un
président du tribunal, M. Chardon, y a fait graver sur le marbre ces mots bien
placés en ce lieu
Quicumque parcit improbis,
probis
nocet.
La grande salle de l' ancienne bibliothèque, surmontée d’une
galerie, est remarquable par ses proportions. Elle a 26 m 70 de longueur sur 11m
60 de largeur et au-dessus de la bibliothèque s’étend une autre vaste salle..
Le souvenir de cette restauration est relaté sur une plaque de marbre
noir placée. sur la face nord.
Voici le texte de l’inscription
Résidence des rois sous les deux premières dynasties,
Devenu au
Xe siècle
le château des comtes d’Auxerre,
Et au XVe le palais du bailliage royal,
Reconstruit partiellement en MDIX, puis en MDCXX,
a été restauré avec façade nouvelle en MDCCCLX VIII,
M. Tarbé des Sablons étant Préfet de 1’ Yonne,
M. Challe, maire,
MM. Barbier,
Baucher, Courot,
Le baron Dernadières, Flocard, Laurent-Lesseré,
Lefêvre, Lepère, Leroy, Lorin, Louzon, Marie,
baron Martineau des Chesnez, Mérat-Beugnon,
Milliaux, Petit-Augé, Piétresson, Plait,
Potenot, Ravin, Rémy, Ribière, Robin, Roger,
Sallé,
Trutey-Marange,
conseillers municipaux.
Nous ne quitterons pas le vieux palais de justice sans faire un retour
sur son passé, et nous emprunterons le sujet de nos récits aux Comptes du
domaine royal d’Auxerre qui sont conservés aux archives de la Côte-d’Or,
série B.
Le palais était, au XVe siècle, le siège de trois juridictions: celle
du prévôt, chargé de réprimer les délits de moindre importance, que nous
appelons correctionnels ; celle du bailli, en appel des sentences du prévôt et
jugeant les affaires civiles des bourgeois du roi, ainsi que les crimes ; enfin
la plus redoutée, celle du prévôt des maréchaux, justice sommaire contre les
vagabonds de toute espèce. Un officier subalterne, le châtelain, avait la
garde du château.
Les degrés de pénalité sont difficiles à fixer: le prévôt pouvait
aller jusqu’à la mort, comme il le fit en 1586, en condamnant une femme à être
pendue et étranglée, et brûlée ensuite, sentence qui fut confirmée par le
Parlement, qui se réservait, heureusement, le droit de révision.
Les causes criminelles étaient, à plus forte raison, du ressort du
bailli : au milieu du XVIe siècle, on lui attribua les accusations d’hérésie,
qui amenaient souvent des sentences de mort, lesquelles étaient révisées au
Parlement.
Chaque juridiction, ou au moins les deux premières qui étaient
permanentes, avait son auditoire distinct. La chambre du conseil occupait
l'ancien cabinet de lecture de la bibliothèque et était, comme son nom
l’indique, le lieu de réunion du gouverneur, du bailli et des autres
officiers du roi. On dépensait, pour la chauffer, en 1479, 12 moules de bois et
150 fagots. La grande salle, qui etait au XIXe siècle la salle de la bibliothèque,
était tapissée de drap bleu fleur-delisé (1571). Messire Jean Rapine, maître-d’hôtel
du roi, était alors gouverneur du comté et recevait 300 livres de gages. Jean
Regnier, bailli du duc de Bourgogne en 1427, le même dont l’effigie est
sculptée sur la façade de l'ancien musée, ne recevait que 400 livres de
gages.
En 1551, le bailliage fut érigé en présidial, tribunal de justice
jugeant souverainement de toutes causes civiles d’une valeur de moins de 250
livres. En 1585, les officiers du bailliage et du présidial réunis, étaient
au nombre de 18. Ils assistèrent à la procession de la Fête-Dieu avec une
torche de cire de 2 livres à la main.
À la même époque, les Cordeliers célébraient la messe quatre fois
par semaine à l’issue des plaids du bailliage, et deux autres jours à
l’issue des plaids de la prévôté.
Le château était divisé en deux cours par un mur (an 1518). Le
gouverneur y avait son logement; mais les remaniements successifs apportés dans
les édifices ne permettent pas d’en restituer la physionomie.
Au-dessous des salles de justice étaient les prisons de différentes
sortes. La prison criminelle, placée sous la chambre du conseil, était comme
un vade in pace; on l’appelait le Crot. Il y avait des prisons
dans la Tour-Gaillarde, dont le mauvais état
permit aux prisonniers de s’évader en 1427. Une autre prison s’appuyait sur
le mur romain qui fermait la cour à l’ouest. Enfin il y en avait une dernière,
appelée la Jacquette (1518).
Voici leur énumération en 1429 : La prison au haut de la Tour-Gaillarde;
la Chambre aux Bourgeois; la Chambre au Muletat; la Chambre qui est dessous,
appelée la Cuotte, et la prison dessus le Crot (B, 2571 ; compte de 1429,
Archives de la côte-d’or).
On fit faire, en 1519, une cage dans le genre de celle où Louis XI
avait fait enfermer La Balue. C’était, dit le compte, une prison de bois de 8
à 9 pieds de longueur, sur 7 de largeur et 6 à 7 de hauteur.
La gehenne ou torture s’appliquait nécessairement dans la prison. En
1504, on établit, à cet effet, près de la chambre du conseil, une pièce de
bois de la longueur de la galerie, ou plusieurs voleurs furent mis à la
question cette année-là. En 1505 on donna l’entretien des prisonniers ou le
geolage à bail, moyennant 6 deniers par prisonnier. Il n’y en eut que vingt
dans l’année.
Disons quelque mots des mœurs judiciaires et des sentences prononcées
au palais pendant les XVe et XVIe siècles.
Les punitions corporelles étaient ordinaires au moyen-âge. Les lois et
les mœurs les avaient établies. La peine de mort, qui soulève tant de répulsion
de nos jours, était fréquemment appliquée. La sévérité répondait-elle aux
nécessités des temps, ou était-elle le produit des mœurs? Peut-être était-ce
l’un et l’autre. Toujours est-il que les détails des comptes de frais de
justice de certaines années sont effrayants.
Ce serait faire de la statistique que de les raconter; nous resterons
dans notre rôle d’anecdotier.
En 1478, trois maîtres des hautes-oeuvres de Paris, de Troyes et de
Sens passèrent à Auxerre « pour sçavoir s’il y a aucunes choses à
besogner de leur office. » il parait que la ville manquait alors de bourreau.
En 1480, celui de Sens, J. Duru, y revint: on lui donna 6 deniers pour acheter
une paire de gants et de couteaux, « pour faire justice. » Il battit de
verges, dans les carrefours de la ville, Martin de Valvin; puis lui coupa
l’oreille et le marqua à la joue. Ce coquin fut banni du comté « pour ses démérites.
»
En 1506, on fustigeait « en chambre » deux individus « pour certain
petit larrecin. » Cet adoucissement n’avait pas toujours lieu. En 1508 on fit
une razzia sur les mendiants étrangers qui se glissaient dans les Hôtels-Dieu,
« vivant sur le bonhomme et usurpant le bien public. » Le bourreau en fustigea
huit dans les carrefours, à 40 sous par tête. En 1537, sur sentence du prévôt,
la femme Rousset fut fustigée dans les carrefours, puis marquée sur le front
d’un fer chaud portant une fleur de lis.
Les hérétiques furent vivement poursuivis à partir de 1538, et
souvent condamnés à mort par le bailli, terrible application des lois qui
n’arrêtait pas les sectaires.
On rouait et on brûlait certains criminels. Bien plus, en 1538, le
bailli condamna à mort, avec des compléments extraordinaires, un nommé Gille
de la Rose, dit Forgeron, grand coupable dont les crimes ne nous sont pas
connus. Le bourreau lui trancha la tête et l’attacha à une potence; puis il
coupa son corps en quatre quartiers qui furent mis aux principales portes de la
ville.
Les suicides étaient aussi l’objet d’une réprobation absolue et
bien légitime. En 1554, le prévôt envoya à la voirie le corps d’un
malheureux, mort de cette manière.
Les troubles du milieu du XVIe siècle avaient jeté dans les campagnes
une foule de coquins, déserteurs des troupes régulières , vagabonds, etc. Il
fallait sévir absolument contre eux, et le prévôt des maréchaux de France
s’en chargea. En 1565 il vint siéger à Auxerre et condamna à la potence,
d’une fournée, sept vagabonds! Le dernier tiers du XVIe siècle vit souvent
des exécutions de ce genre, en moindre nombre toutefois.
Terminons ces récits par un fait plus digne de souvenir. C’est dans la grande salle du palais que se tint, en mars 1789, l’assemblée du Tiers-Etat du bailliage, qui devait envoyer pour députés aux Etats-Généraux, MM. Marie de la Forge et Paultre, de Saint-Sauveur.
Lire aussi : Les prisons d'Auxerre au XVIIIe siècle